Sécheresse intense : quels sont les risques et les stratégies de réponse ?
Publié le
Vagues de chaleur, sécheresses, pluies torrentielles, le changement climatique va intensifier le nombre d’épisodes climatiques extrêmes. Ces dernières années se caractérisent par des sécheresses sans précédent… Quels sont les impacts de ces épisodes et comment en atténuer les conséquences ?

Sécheresse, canicule, évapotranspiration … les éléments d’un épisode extrême
Il existe plusieurs types de sécheresse :
- La sécheresse météorologique qui correspond à un déficit prolongé de précipitations.
- La sécheresse du sol, dite aussi sécheresse agricole, qui résulte d’un manque d’eau disponible dans le sol pour les plantes, ce qui impacte toute la production végétale, et indirectement la production animale.
- La sécheresse hydrologique qui correspond à un déficit de débit des cours d’eau, des niveaux bas des nappes ou des retenues, sur une période ou une année pendant laquelle les débits sont très inférieurs à la moyenne. Elle peut provoquer des assecs (absence d’écoulements) sur certains cours d’eau.
(INRAE : Qu’est-ce que la sécheresse ? )
La canicule se caractérise par des fortes températures cumulées le jour et la nuit avec plusieurs conséquences sur les milieux :
- augmentation de la température de l’eau des rivières et des lacs ;
- dégradation par brulure du système foliaire des plantes ;
- augmentation de l’évapotranspiration.
L’évapotranspiration correspond à l’émission de vapeur d’eau dans l’atmosphère depuis les surfaces aquatiques, le sol et la surface des végétaux.
On distingue deux phénomènes naturels qui rejettent de l’eau dans l’atmosphère :
- l’évaporation de l’eau du sol et des milieux aquatiques ;
- la transpiration des plantes, un processus biologique et mécanique, par lequel les végétaux perdent de l’eau.
Anticiper le déséquilibre entre besoins en eau et ressource disponible dans le bassin Adour-Garonne
-
Le bassin Adour-Garonne est l’un des plus exposés au changement climatique. D’ici 2050, il pourrait connaître un déficit de 1,2 milliard de m³ d’eau par an, soit près de la moitié des prélèvements actuels. Pour y répondre, le comité de bassin a adopté une stratégie de gestion quantitative, fondée sur un mix de solutions mobilisant tous les leviers disponibles.
- Cette stratégie associe sobriété des usages, évolution des pratiques agricoles, réutilisation des eaux usées, stockage et solutions fondées sur la nature.
« Un mix de solutions pour le bassin Adour-Garonne - Eau 2025-2030 »
Les effets immédiats et à long terme de la sécheresse
Quand la quantité diminue, la qualité également… La sécheresse a des impacts sur la qualité des eaux. Elle crée un risque de pollution de la ressource car sa capacité de dilution des rejets est moindre. L’augmentation des températures favorisent également le développement des algues et des cyanobactéries…
Les impacts sur la faune, la flore et les écosystèmes aquatiques sont importants, entrainant notamment d’importantes mortalités ou des migrations chez certaines espèces.
En période de tension sur la quantité d’eau disponible, l’ensemble des usages de l’eau est impacté et des conflits peuvent naître.
-
Pour l’eau potable
L’accès à l’eau potable peut être perturbé en période de grande sécheresse. Durant l’été 2022 plus d’une centaine de communes du bassin du Grand Sud-Ouest ont eu recours au citernage ou à l’interconnexion pour maintenir l’accès à l’eau potable de leurs administrés.
La potabilisation de l’eau exige le respect de certains critères de qualité et de température de l’eau prélevée qui peuvent être altérés en période de sécheresse. Certaines communes sont également concernées
-
Pour l’agriculture
Le besoin en eau des plantes accru en période de sécheresse et la disponibilité de l’eau restreinte conduit à des baisses de rendement et des pertes pour le monde agricole. L’élevage peut également rencontrer des difficultés notamment pour l’abreuvement des animaux.
-
Pour les activités économiques et industrielles
Les activités économiques et industrielles qui dépendent de l’eau doivent adapter leurs niveaux de production lorsque des arrêtés de restriction sont pris. Certaines activités doivent s’arrêter lorsque la qualité et/ou la température de l’eau dépasse certains seuils …
Le soutien d’étiage se fait en partie avec des réserves hydroélectriques créant des risques de tension sur la fourniture énergétique.
Sur le long terme, les impacts de la sécheresse sont nombreux. Elle peut notamment jouer un rôle, si rien n’est fait, de facteur aggravant du changement climatique.
Quest ce que
le soutien d'étiage ?
Lâchers d’eau issus de retenues pour maintenir un débit minimum d’eau dans les rivières afin de préserver la vie aquatique en période d’étiage (entre juin et fin octobre).
Il est mis en œuvre avec le soutien financier de l’agence de l’eau, par les établissements publics de bassin ou des organismes gestionnaires qui adaptent au mieux les quantités d’eau à déstocker jour après jour.
Crise « sécheresse », quelles réponses immédiates ?
Les épisodes de sécheresse donnent lieu à des mesures de gestion de crise. Une veille permanente est assurée par l’Etat afin de suivre l’état de la ressource en eau, faciliter les échanges et la concertation entre acteurs.
Il s’agit de préparer, coordonner et suivre les mesures adoptées pour répartir la ressource en eau entre usages. Elles sont de deux grands ordres :
- Les restrictions de prélèvements ou d’activités et les éventuelles dérogations relèvent des compétences du Préfet de bassin. Elles sont proportionnées, adaptées et évoluent en fonction de l’état de la ressource en eau. Des dérogations pour certaines activités économiques ou cultures peuvent être prévues.
- L’adaptation des consignes du soutien d’étiage en durée et en volume en relation avec les organismes gestionnaires
+ de 100 communes du bassin en difficulté d'accès à l'eau potable durant l' été 2022
25 départements du bassin (sur 25) soumis à des restrictions d'usages en août 2022
57,2 M de m3 d'eau lachés lors de la campagne de soutien d'étiage 2022 sur la Garonne
Sécheresse : des actions de long terme et stratégies d’adaptation
Le plan d’adaptation au changement climatique (PACC), l’entente pour l’eau du bassin Adour-Garonne, le plan stratégique de retour à l’équilibre et le SDAGE prévoient un mix de solutions à promouvoir sur le long terme pour préparer les épisodes à venir.
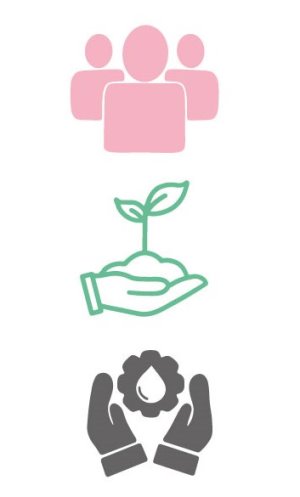
Les mesures sont de trois ordres :
- Les mesures immatérielles qui vont permettre la prise de conscience de la nécessité d’agir et de modifier les pratiques (sobriété), promouvoir la recherche et la connaissance, faciliter une gouvernance locale et toujours plus intégrée des enjeux de l’eau. Favoriser les démarches co-construites avec les acteurs du territoire.
- Le recours aux solutions fondées sur la nature telles que la désimperméabilisation et la renaturation des villes, la restauration des cours d’eau et des zones humides, le développement de l’agroécologie…
- Des mesures techniques ou des ouvrages hydrauliques comme l’amélioration des performances du réseau d’eau potable, le soutien d’étiage, le recyclage des eaux usées traitées, la mobilisation des volumes non utilisées dans les retenues existantes, la recharge dynamique des nappes, la création de réserves d’eau …
Ces actions pourront être combinées en fonction des besoins et spécificités du territoire, dans une optique de complémentarité et afin d’être mieux préparés aux changements à venir.
Quelques exemples de solutions sur le territoire
-
Démonstrateur Charente : un laboratoire d'innovation pour l'adaptation au changement climatique
Le bassin de la Charente devient un véritable laboratoire, sélectionné par le Comité de bassin et l’agence de l'eau Adour-Garonne dans le cadre de son 12e programme, pour expérimenter, innover et démontrer que des solutions ambitieuses et coconstruites sont possibles.
Le démonstrateur Charente, c’est :
✔ Créer et tester des démarches innovantes
✔ Mettre en lumière des solutions concrètes à l’échelle locale
✔ Accélérer et massifier les actions
✔ Inspirer d’autres bassins versants
L'objectif : améliorer la qualité de l’eau, réduire le déficit estival, et renforcer la résilience du territoire.
« Démonstrateur Charente : un laboratoire d'innovation pour l'adaptation au changement climatique »
-
L'exemple de Felix Noblia qui pratique l'agroécologie
Dans l'agroécologie, chaque geste compte !
Nous vous invitons à la rencontre de Félix Noblia sur son exploitation du pays basque !
Les vaches ne mangent que l'herbe de ses prairies
Pas de labour, entre les récoltes du trèfle et de la luzerne pour une terre couverte et nourrie
Des sols épais et enrichis stockent l'eau et permettent une baisse du besoin d'irrigation d'environ 20%
« [À LA SOURCE] Qu'est-ce que l'agroécologie »
-
L'exemple du causse Méjean : pour une gestion durable de l'abreuvement du bétail
En Lozère, le causse Méjéan connait depuis de nombreuses années des tensions récurrentes sur le réseau de distribution d’eau potable en période estivale notamment. L’abreuvement des bêtes, s’ajoutant à la consommation de la population locale plus importante en période estivale, devient un enjeu de partage de la ressource pour éviter les difficultés d’approvisionnement en eau potable.
3 ans après la crise de 2022, la collectivité en charge de l’eau potable a porté le projet collectif de réduction des besoins en eau potable des exploitations agricoles par la substitution des besoins d’abreuvement du cheptel et stratégie globale de sobriété.
36 exploitations agricoles volontaires permettront de réduire de 30% en moyenne les prélèvements sur l’unité de distribution d’eau potable du causse Méjéan avec des économies d’eau potable de l’ordre de 25 000 m3/an.
« Gestion durable de l'abreuvement du bétail dans le causse Méjean »
-
L'exemple du lac vert d’Agos-Vidalos : un projet de renaturation innovant et ambitieux !
Détruit lors de la crue de juin 2013, le complexe aquatique de plein air a trouvé une nouvelle forme !
Le projet de renaturation a transformé cette base de loisirs de 8,7 hectares en outil de lutte contre les crues : une fois les installations démantelées, une brèche dans la digue permet au gave de Pau de s’y étendre lors de montées des eaux et une zone-humide a été créée.
Une opération exemplaire menée en partenariat avec la fondation des pêcheurs.
Plus de liberté pour la rivière et les espèces qui en dépendent, telles la loutre ou le saumon de l’Atlantique!
-
Des exemples de Réutilisation des Eaux Usées Traitées ou eaux non conventionnelles
3 exemples :
- à Foissac dans l'Aveyron récupération des eaux de pluie pour l'abreuvement du bétail permettant de limiter les conflits d'usages avec l'eau potable
- à Rochefort les eaux usées permettent d'alimenter les lagunes et préserver la biodiversité
- dans les Landes, à l'abattoir du Raguet les eaux usées traitées permettent d'irriguer une parcelle à proximité
« Réutilisation des eaux : exemples dans le grand Sud-Ouest »